La pratique picturale, chez Novarina, est intimement liée à sa pratique littéraire et à sa conception de l’écriture comme incarnation du langage et de la pensée sous une forme dramatique, sur l’espace scénique. L’acte de paroles, cette série de 20 toiles, présentée en la chapelle du Quartier Haut, est ainsi étroitement dépendante de la représentation de sa pièce, L’animal imaginaire, au théâtre Molière, à Sète, représentée les 14 et 15 janvier.
Tout d’abord, le recours à un fond noir ou blanc, avec la symbolique immédiate que l’on peut en induire (jour/nuit, lumière/obscurité, naissance/mort, néant/être…) s’adapte superbement à l’infrastructure des lieux anciennement sacrés mais à présent désaffectés caractérisés par ces deux valeurs dominantes. Sur ces toiles, généralement carrées, et de dimension surhumaines, occupant généreusement l’espace, Novarina, laisse surgir des formes colorées, un peu comme on laisse surgir des pensées, dans un esprit d’attente curieuse et prospective, de découverte et d’émerveillement face à ce qui va jaillir des outils de travail convoqués.
Si l’abstraction cherche à s’imposer – elle est un peu l’expression de l’inconscient qui ne se livre pas tout de go et a besoin d’être déchiffré – on ne manquera pas de repérer des ébauches de figures, des créatures fœtales ou ectoplasmiques, tout un théâtre d’ombres, faisant penser à des animaux mais essentiellement anthropomorphes, des profils, des corps étirés, distordus, disloqués, symboliques – mais bien présents. L’ensemble donne l’impression d’un tourbillon pulsionnel, d’autant que rien n’empêche l’artiste de tourner autour du support au sol ou de changer de côté quand le besoin s’en fait sentir et qu’il travaille contre le mur. D’où le caractère généreux, pour reprendre une expression d’Henri Darasse, de cette peinture emplie d’énergie, de velléités chorégraphiques car ici comme ailleurs c’est le corps qui s’exprime par le truchement des gestes qui sont comme l’amorce de la pensée. Et qui s’exprime en l’espace prosodique de la toile. C’est ce qui donne à la production de Valère Novarina cet aspect génétique, comme si le monde fait pensée se recréait sous nos yeux car pour lui la pensée se voit, tandis que le langage s’entend (ce que l’on peut vérifier dans son théâtre).
 Evidemment cette peinture n’a rien d’académique. Novarina se moque bien des codes de la composition. Elle a au contraire quelque chose de brut voire d’enfantin, mais à grande échelle : ainsi que le disait Baudelaire, si le génie n’est que l’enfance retrouvée, (il est) doté maintenant d’organes virils et de l’esprit analytique. Le choix des couleurs est certes impulsif mais il produit du sens. Novarina conclut d’ailleurs la réalisation de ses toiles par un titre qui relève d’une interprétation singulière en rapport avec son univers de créateur (l’un de ses acteurs l’a, à juste titre, et en toute tendre ironie surnommé Dieu tandis que nous bavardions avec le peintre-écrivain-dramaturge ), en général renvoyant à l’univers sacré, biblique (référence à Adam bien évidemment, le premier corps, la première pensée, la premier mot, la première mort humaines, à David, le prophète, à Abraham le premier sacrificateur du règne animal… ; Dormition virginale…, Exode…). Mais aussi à son monde spécifique, celui des logaèdres et de la difficile incarnation (le corps des acteurs incarnant la pensée favorisée par le langage au théâtre).
Evidemment cette peinture n’a rien d’académique. Novarina se moque bien des codes de la composition. Elle a au contraire quelque chose de brut voire d’enfantin, mais à grande échelle : ainsi que le disait Baudelaire, si le génie n’est que l’enfance retrouvée, (il est) doté maintenant d’organes virils et de l’esprit analytique. Le choix des couleurs est certes impulsif mais il produit du sens. Novarina conclut d’ailleurs la réalisation de ses toiles par un titre qui relève d’une interprétation singulière en rapport avec son univers de créateur (l’un de ses acteurs l’a, à juste titre, et en toute tendre ironie surnommé Dieu tandis que nous bavardions avec le peintre-écrivain-dramaturge ), en général renvoyant à l’univers sacré, biblique (référence à Adam bien évidemment, le premier corps, la première pensée, la premier mot, la première mort humaines, à David, le prophète, à Abraham le premier sacrificateur du règne animal… ; Dormition virginale…, Exode…). Mais aussi à son monde spécifique, celui des logaèdres et de la difficile incarnation (le corps des acteurs incarnant la pensée favorisée par le langage au théâtre).
Au cœur de la chapelle, Novarina a également conçu un Chemin de vie, longue énumération dont il a l’habitude dans ses morceaux de bravoure théâtraux.
La pièce, le 14 au soir, fut une réussite. Les acteurs sont de véritables performeurs à même de mémoriser, expression corporelle à l’appui, des monologues ou tirades
 extrêmement difficiles, telle celle du Romancier accumulant les stichomythies accompagnées des incontournables verbes introducteurs dans les romans un peu faciles ; ou le Grand Communicateur énumérant les nouvelles du jour dans le plus pur style novarinien, inventif et frénétique ; les démonstrations pseudo scientifiques de Raymond la Matière… Le langage s’incarne sous nos yeux et dans nos oreilles, la chanson joue un grand rôle à l’instar de la tradition brechtienne, les discours accélèrent jusqu’à l’épuisement, les homéotéleutes (jeux avec les voyelles), le balbutiement, la glossolalie, la toux même…
extrêmement difficiles, telle celle du Romancier accumulant les stichomythies accompagnées des incontournables verbes introducteurs dans les romans un peu faciles ; ou le Grand Communicateur énumérant les nouvelles du jour dans le plus pur style novarinien, inventif et frénétique ; les démonstrations pseudo scientifiques de Raymond la Matière… Le langage s’incarne sous nos yeux et dans nos oreilles, la chanson joue un grand rôle à l’instar de la tradition brechtienne, les discours accélèrent jusqu’à l’épuisement, les homéotéleutes (jeux avec les voyelles), le balbutiement, la glossolalie, la toux même…
Ainsi le drame de l’animal parlant se rejoue-t-il dans ses grandes lignes et dans ses variations infinies. L’acteur, comme les outils et couleurs sur la toile, est de passage. Il ne naît que pour mourir. De ce point de vue, Novarina est dans la continuité de Beckett. 
Les toiles nous les retrouvons sur la scène : l’une gigantesque et qui donne le ton. D’autres, manœuvrés par les acteurs et machinistes, échangeant éventuellement leurs rôles, plus petites, qui épousent les changements de tableaux, quand les innombrables personnages du bestiaire humain qu’engendre Novarina font leur tour de piste avant que de disparaître… jusqu’à la prochaine représentation.
L’œuvre de Novarina métaphorise et réalise à la fois notre parcours vital d’animal du langage, de corps qui agit dans l’espace, de mots qui finissent par traduire une pensée.
BTN










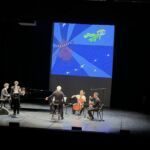
























 Evidemment cette peinture n’a rien d’académique. Novarina se moque bien des codes de la composition. Elle a au contraire quelque chose de brut voire d’enfantin, mais à grande échelle : ainsi que le disait Baudelaire, si le génie n’est que l’enfance retrouvée, (il est) doté maintenant d’organes virils et de l’esprit analytique. Le choix des couleurs est certes impulsif mais il produit du sens. Novarina conclut d’ailleurs la réalisation de ses toiles par un titre qui relève d’une interprétation singulière en rapport avec son univers de créateur (l’un de ses acteurs l’a, à juste titre, et en toute tendre ironie surnommé Dieu tandis que nous bavardions avec le peintre-écrivain-dramaturge ), en général renvoyant à l’univers sacré, biblique (référence à Adam bien évidemment, le premier corps, la première pensée, la premier mot, la première mort humaines, à David, le prophète, à Abraham le premier sacrificateur du règne animal… ; Dormition virginale…, Exode…). Mais aussi à son monde spécifique, celui des logaèdres et de la difficile incarnation (le corps des acteurs incarnant la pensée favorisée par le langage au théâtre).
Evidemment cette peinture n’a rien d’académique. Novarina se moque bien des codes de la composition. Elle a au contraire quelque chose de brut voire d’enfantin, mais à grande échelle : ainsi que le disait Baudelaire, si le génie n’est que l’enfance retrouvée, (il est) doté maintenant d’organes virils et de l’esprit analytique. Le choix des couleurs est certes impulsif mais il produit du sens. Novarina conclut d’ailleurs la réalisation de ses toiles par un titre qui relève d’une interprétation singulière en rapport avec son univers de créateur (l’un de ses acteurs l’a, à juste titre, et en toute tendre ironie surnommé Dieu tandis que nous bavardions avec le peintre-écrivain-dramaturge ), en général renvoyant à l’univers sacré, biblique (référence à Adam bien évidemment, le premier corps, la première pensée, la premier mot, la première mort humaines, à David, le prophète, à Abraham le premier sacrificateur du règne animal… ; Dormition virginale…, Exode…). Mais aussi à son monde spécifique, celui des logaèdres et de la difficile incarnation (le corps des acteurs incarnant la pensée favorisée par le langage au théâtre). extrêmement difficiles, telle celle du Romancier accumulant les stichomythies accompagnées des incontournables verbes introducteurs dans les romans un peu faciles ; ou le Grand Communicateur énumérant les nouvelles du jour dans le plus pur style novarinien, inventif et frénétique ; les démonstrations pseudo scientifiques de Raymond la Matière… Le langage s’incarne sous nos yeux et dans nos oreilles, la chanson joue un grand rôle à l’instar de la tradition brechtienne, les discours accélèrent jusqu’à l’épuisement, les homéotéleutes (jeux avec les voyelles), le balbutiement, la glossolalie, la toux même…
extrêmement difficiles, telle celle du Romancier accumulant les stichomythies accompagnées des incontournables verbes introducteurs dans les romans un peu faciles ; ou le Grand Communicateur énumérant les nouvelles du jour dans le plus pur style novarinien, inventif et frénétique ; les démonstrations pseudo scientifiques de Raymond la Matière… Le langage s’incarne sous nos yeux et dans nos oreilles, la chanson joue un grand rôle à l’instar de la tradition brechtienne, les discours accélèrent jusqu’à l’épuisement, les homéotéleutes (jeux avec les voyelles), le balbutiement, la glossolalie, la toux même…









0 commentaires