Le titre de cette exposition collective suppose un état d’urgence et, bien entendu, quatre protagonistes. En fait, si les artistes diffèrent dans leur support et dans leur facture, ils ont un commun une vision du monde hantée par les grands conflits terrestres et la destruction de l’espèce. Commençons par un sétois, André Cervera qui a invité, pour l’occasion une indienne, Swarna Chitrakar, ainsi que le cinéaste bengali Mithun Pramanik qui rend compte de leur expérience commune. Les toiles, de lin ou de jute, de divers formats, font ainsi dialoguer le passé mythique, culturel et religieux de chaque artiste à la réalité présente des actualités tragiques telles que les attentats récents, le tsunami dévastateur voire même les inquiétudes apocalyptiques. Les œuvres sont réalisées à quatre mains et atteignent graduellement le stade de l’osmose, en tout cas d’un dialogue entre l’orient et l’occident, l’Asie et la vieille Europe si marquée par l’imaginaire américain. Du coup, c’est à une production cosmopolite, que nous avons affaire, et humaniste. On retrouve les masques qui hantent les travaux de Cervera, son goût pour lé décoratif, son insistance sur le redressement mural, ses personnages grotesques et hiératiques, ses couleurs sourdes également liées à l’emploi du support, son humour distancié également, conjugué à la prolifération des personnages divins ou héroïques qui caractérisent la culture indienne, l’accent mis sur les regards chargés d’émotion, l’éclat décomplexé des couleurs aussi. L’ensemble fonctionne et convainc, à l’instar des réussites que sont La réconciliation (où dieux et démons palabrent autour d’une table), David et Goliath (où le géant philistin parade devant le minuscule peuple indien), ou le labyrinthe de Thésée où les personnages se répondent superbement. Les natures mortes, une scène de la vie urbaine et la mythologie de chacun flottant sur l’espace de la toile (Entre deux mondes) complètent cette expo, où l’on peut apprécier également des peintures végétales et minérales sur papier canson, relevant d’une autre esthétique, plus artisanale. Bref un très beau travail et une idée sous exploitée par les artistes, plutôt tournés vers leur ego, de collaboration interculturelle, supposant des traits d’union et points communs là où le profane ne remarquerait que les différences. Un pas vers la paix en tout cas, que l’on retrouve chez le plus ancien des quatre (ou cinq) invités, Thierry Delaroyère s’exprime dans l’abstrait : ces toiles s’avèrent tantôt charpentée de puissantes lignes de force noires, tantôt rythmée de taches colorées plus élégantes, le plus souvent composées de constructions au trait, des sortes de réseaux où viennent s’égrener des variations diaprées. Enfin la peinture dégouline sur la toile du fait de son redressement mural. Tout cela concourt à créer une ambiance qui se prête au drame, ce que confirment les titres. Et effectivement, une simple colombe dessiné traverse ou survole le tableau pour appeler à une paix, momentanée, puisque les tableaux se succèdent sans répit. Parfois ce sont des barques de migrants qui sont suggérées. Marocain d’origine, Mohamed Lekleti vit à Montpellier. Il s’est crée un univers bien à lui, essentiellement graphique, où la surprise est toujours au rendez-vous. Qu’il s’agisse d’enfants qui jouent, d’animaux qui voyagent ou d’adultes en mouvement, on a l’impression d’être plongé en plein rêve ou cauchemar, où toutes les métamorphoses sont possibles. Cela ne va pas sans susciter le malaise, d’autant que l’artiste pousse parfois jusqu’au macabre, mais ses œuvres rendent bien compte de l’inquiétude qui ne peut que saisir l’esprit d’un artiste normalement constitué de nos jours. On a l’impression que Lekleti intègre en lui toute la violence du monde pour la restituer, passé au rible de l’imaginaire. L’hybridation, la distorsion, la menace mais aussi le mystère composent ce monde. Lekleti sort toutefois du dessin et de son monde malmené pour nous ramènent à la réalité par le biais d’un oiseau soumis à taxidermie, dont la présence demeure au demeurant ambiguë. Est-elle rassurante ou entraîne-t-elle la notion de fatalité. L’artiste en tout cas dans un autoportrait où il montre que la cause palestinienne ne lui est pas indifférente. Le dernier artiste est un photographe qui nous vient de Toulouse, l’occitane. Évidemment, on se dit que la photographie témoigne d’un rapport plus direct avec le monde que la peinture qui crée toujours un univers à part, décalé. Ce n’est pourtant pas toujours vrai, d’abord parce que la réduction et l’aplatissement du motif choisi en modifient la vision, ensuite parce que le noir et blanc transforme sensiblement la réalité, mettant en évidence les valeurs. Pascal Fayeton cherche plutôt dans l’immémorial, les pierres ancestrales témoignant d’une autre histoire voire de la préhistoire. Ses paysages, méditerranéens par exemple, sont la plupart du temps déshumanisés, livrés à l’état sauvage et comme hors du temps. L’emploi de la couleur, dans les Mues par ex, peut paraître pictural. On est en tout cas dans une vision plus apaisée du monde même si certaines stèles peuvent faire penser à un désastre ancien. Photos, dessins, peinture abstraite, peinture figurative : quatre façons de s’affilier au sujet qui réunit ces artistes autour d’une implication dans le monde réel. Celle de Cervera et Swarna prend l’actualité tragique à bras le corps, Delaroyère y fait discrètement allusion, Lekleti nous plonge dans l’ambiance qui l’ vue naître tandis que Fayeton nous en livre une version fondamentale et plus apaisée. On profitera de la visite pour apprécier les livres d’artistes, portraits et tableaux de la collection Salah Stetié. BTN
Jusqu’au 20 mai au Musée Paul Valéry 148, rue François Desnoyer à Sète. Tel : 0499047416










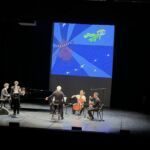































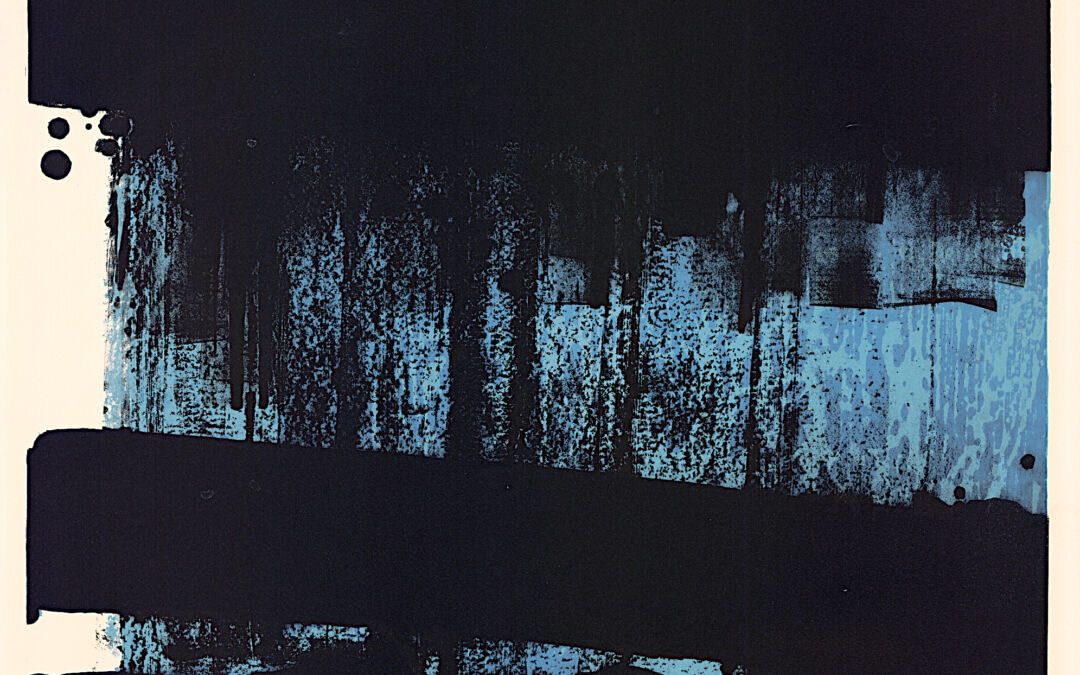
0 commentaires