Nouveau directeur général du MO.CO. de Montpellier, Numa Hambursin prendra ses fonctions le 1er juillet prochain. Le critique d’art, également directeur artistique de la Fondation GGL Hélénis, nous a accueilli chez lui, à Clapiers, pour une rencontre en toute intimité. Cet entretien, mené par BTN, notre rédacteur arts plastiques, est une discussion entre deux critiques d’art pour évoquer la mission que Numa Hambursin devra mener dans ses nouvelles fonctions. Dans cette interview, ils parlent aussi ensemble de son parcours, ses convictions, et ses envies.
BTN : Avant de commencer, où sommes-nous exactement ? En quel lieu ?
NH : Nous sommes à Clapiers, dans une demeure néo-gothique construite en 1873 par Max Leenhardt, peintre montpelliérain, cousin de Frédéric Bazille et élève de Cabanel. C’est un peintre huguenot méridional. Il imaginait faire carrière à Paris mais malheureusement, à 40 ans, il a perdu sa jeune épouse décédée en couche et a dû quitter la capitale pour vivre à Clapiers. Cette maison a été son désert de la Thébaïde. Je m’y retrouve. Clapiers, c’est ma grotte. C’est une maison d’artiste, rêvée pour des artistes, et qui au fil des générations en a accueilli beaucoup. J’aime m’y retirer, m’occuper du jardin, lire, m’y ressourcer. C’est mon antre et j’y suis très attaché.
Évoquons vos origines. Vous êtes Montpelliérain ?
Je me qualifie surtout comme méridional. Quand on m’interroge sur mes origines, je pense immédiatement à ma grand-mère maternelle. Elle venait d’une famille cévenole modeste et a vécu une ascension sociale formidable grâce à la méritocratie républicaine. Elle a été médaille d’or de la Faculté de pharmacie, une des premières femmes. Dans mon enfance, elle me faisait la lecture d’Alphonse Daudet et de Frédéric Mistral. Elle a eu une influence fondamentale sur moi. D’un point de vue géographique, je me sens viscéralement attaché à ce périmètre qui va de Collioure à Menton. D’un point de vue intellectuel, elle m’a donné le goût du récit, du conte. Cela a sans aucun doute contaminé mes goûts en matière d’art contemporain. J’aime les histoires. Je le tiens de ma jeunesse, qui a été très heureuse.
Votre scolarité, vos études supérieures vous orientaient-elles du côté de l’art ?
Non, pas vraiment. J’ai eu une bonne scolarité, plutôt littéraire. Après avoir beaucoup bataillé au sein de ma famille, j’ai vécu mon passage en première littéraire comme une libération. Nous étions seulement deux garçons dans une classe de 28 filles. Pour moi qui ne me sentais pas très à l’aise dans les activités sportives ou les enjeux de virilité adolescents, c’était un vrai bonheur. À 18 ans, je suis allé suivre mon hypokhâgne à Paris mais j’avais la nostalgie de ma région. J’ai étudié le droit, à Paris et Montpellier : maîtrise de droit public, diplôme universitaire de sciences politiques et un master 2 de droit du patrimoine culturel où j’ai notamment travaillé sur la préservation du patrimoine immobilier africain. En parallèle, j’avais écrit des petits textes pour des artistes et j’ai senti que cette histoire-là m’appelait davantage. Avec le métier de ma mère, galeriste d’art contemporain depuis 1974, j’étais en fait embarqué dans ce monde depuis longtemps. Si bien qu’à 23 ans, après mes études, forcé par les circonstances de la vie, je décide d’ouvrir… une galerie !
« Le grand plaisir consiste pour moi à être seul face à une œuvre. Dans le silence. »
On peut donc dire que, vers cet âge-là, votre passion pour l’art semble s’orienter vers une vocation voire une carrière…
J’ai eu la chance, par ma mère, de côtoyer des artistes très jeune. Certains faisaient partie de la famille. Quand à table, on parlait de Christine, c’était naturellement Christine Boumeester. J’ai toujours visité des ateliers. A huit ans, je me revois dans celui de Louis Cane et je me souviens avoir été fasciné par l’ampleur du personnage, de ses toiles, immenses, impressionnantes, et par l’odeur de la peinture. J’avais la sensation d’être dans un laboratoire d’alchimiste et cette impression ne m’a jamais quitté. J’adore aller dans les ateliers. Je me sens comme chez un magicien. Je me souviens aussi d’Henri Goetz à Montpellier un an avant sa mort. Il dessinait et je lui tournais autour à la manière du petit prince lui demandant s’il ne pouvait pas quitter ses cercles et triangles un instant pour dessiner des choses plus intéressantes, comme des animaux. Il m’en a dessiné des animaux, et je les ai gardés, tout comme un plâtre offert par Louis Cane. Voir ces animaux sortir de sa main, c’était fascinant. En revanche, à dix ans, j’ai raté Olivier Debré, je lui ai préféré la lecture du journal de Mickey dans la voiture. Aujourd’hui je dis tout le temps à mes enfants d’en profiter.
Plus tard, à 13-14 ans, je suis envoyé en voyage linguistique à Madrid. J’étais complètement libre et on m’avait conseillé d’aller au Prado. Et là, j’ai une sorte de trou noir : pendant quinze jours, je passe toutes mes journées au musée. J’arrivais le matin et je repartais le soir. Je ne parviens toujours pas à m’expliquer comment j’ai pu, à cet âge, être absorbé à ce point par un musée, ses Goya, ses Zurbaran, Bruegel… J’en suis ressorti avec cette passion complète pour les artistes que j’y avais rencontrés. A mon retour, au lycée, tous les jours, j’allais entre midi et deux au Musée Fabre, ancienne génération. Il n’y avait personne. Le plancher craquait. J’étais seul avec les chefs d’œuvre. J’ai associé la découverte des chefs d’œuvre à une forme de solitude. Le grand plaisir consiste pour moi à être seul face à une œuvre. Dans le silence. Cela ne m’empêche pas de comprendre parfaitement le besoin de communication et de médiation qui s’impose aujourd’hui, mais je pense qu’il faut essayer d’éveiller en chacun ce plaisir, si puissant, si libérateur, qu’est l’intimité avec une œuvre d’art.
Y’a-t-il eu un moment déterminant dans la prise de conscience de votre vocation ?
Au début je m’intéressais donc surtout à l’art ancien, à la peinture classique. Petit à petit la modernité est entrée en moi. J’ai eu une passion pour Picabia, Picasso, Miro et très vite évidement j’ai été rattrapé par l’art contemporain. Une personnalité comme Robert Combas a été déterminante. Je publie un texte sur lui pour une exposition. Il aime le texte et décide de l’inclure dans un catalogue sur les tatouages académiques. Cette expérience a été un choc. Quand j’ai reçu le catalogue imprimé, ça a été une révélation : c’est ça que je veux faire, écrire ! Je trouve dans la critique d’art ma voie et ma voix. Je me rends compte que la manière dont je tourne des phrases, exprime mieux que je ne le ferai à l’oral ce que je suis et la manière dont je pense. Je passe par l’autre et par l’œuvre pour parler de moi. C’est un principe que je conserve encore aujourd’hui : renvoyer à ma propre échelle, à ma subjectivité. Mauriac faisait de même dans ses articles de presse. Il pouvait partir d’un fait extérieur au sujet principal, une fleur dans le jardin de Malagar par exemple, pour retomber sur l’analyse d’une question grave, comme la Guerre d’Algérie. Cela donne une profondeur poétique et philosophique toute particulière à son écriture.
« J’ai eu une passion pour Picabia, Picasso, Miro et très vite évidement j’ai été rattrapé par l’art contemporain. Une personnalité comme Robert Combas a été déterminante. »
Venons-en à votre expérience de galeriste.
En 2003, nous ouvrons avec Clémence Boisanté une galerie près du centre d’Avignon. Nous ne la garderons qu’un an. Avignon s’est révélé une ville sans émulation. La Collection Lambert y vivait en autarcie, sans connexion avec le reste de la ville. Nous avons commencé par exposer Claude Viallat et Daniel Dezeuze. Ensuite, nous décidons d’ouvrir une galerie à Montpellier, Boulevard du jeu de Paume avec des grands noms comme Bernard Pagès ou Erro, mais aussi des plus jeunes comme Carole Benzaken ou François Boisrond. Viendront après des artistes de notre génération issus des Beaux-Arts de Paris comme Farah Atassi, avant qu’elle ne soit connue. Le programme avait une prédilection pour la peinture figurative à une époque où elle était encore très décriée en France. Les peintres étaient comme des hussards, mais cela ne nous a pas empêché d’exposer aussi de la photo, de la vidéo, des installations… Nous faisions, déjà, très attention à présenter autant d’hommes que de femmes. Ça a été une très belle aventure. J’ai une tendresse toute particulière pour ce métier de galeriste, qui suppose que l’on s’y dévoue corps et âme. On y noue avec les artistes des liens quasiment familiaux. Certains t’appellent tous les jours. On entre dans une sorte de communauté… En institution, on voit l’artiste deux-trois fois puis la relation s’arrête une fois l’exposition bouclée. Ce n’est pas le cas en galerie, où l’on doit toujours suivre au quotidien, soutenir, exposer et réexposer… On accompagne l’artiste dans tous les aspects de sa carrière : catalogues, commandes, projets de musées, résidences etc.
L’expérience professionnelle de votre mère vous a été précieuse ?
Oui. L’observer, l’écouter a été une grande source d’enseignement. Mais la plus belle leçon qu’elle m’ait donnée, et je l’admire pour cela, c’est qu’elle a toujours été fidèle à ses goûts, à sa vision, sans jamais se laisser entraîner par les effets de mode. Elle défendait ses artistes bec et ongles à tel point que de temps en temps, elle avait du mal à voir les autres. Quand elle participait à une discussion sur l’art, elle faisait toujours retomber le débat sur ses artistes. Elle a noué avec eux des relations très fortes et ne s’est jamais laissé intimider par les critiques ou la nouveauté. (coup de fil opportun de Vincent Bioulès. Pause).
Revenons à la critique d’art. Comment en êtes-vous venu à la pratiquer régulièrement ?
Le métier de galeriste me plaisait beaucoup mais n’était pas fait pour moi car je n’étais pas à l’aise avec la vente, ce qui est tout de même un problème… J’aimais tout ce qui était autour mais pas le cœur même du métier (rires). J’ai commencé à écrire des préfaces de catalogues pour la galerie. J’étais libre. Cela m’a permis d’apprendre à écrire comme j’en avais envie et de le faire sans contrainte. Je voulais une écriture ciselée et je l’ai travaillée d’arrache-pied. Très vite les artistes m’ont réclamé des textes. Je n’avais que 25-26 ans. Petit à petit, j’ai travaillé cette écriture en lisant beaucoup. Je cherchais des auteurs qui correspondaient à ma manière de voir les choses. Paul Léautaud m’a beaucoup inspiré, dans sa manière de sauter du coq à l’âne, du personnel à l’artistique, de raconter aussi une histoire qui finit par la critique d’art (il était critique de théâtre). Ça peut paraître bizarre car c’est un auteur qui semble décalé mais il m’a beaucoup appris.
Nous en arrivons donc à votre expérience de curateur, au Carré Sainte Anne. J’ai passé un cap quand l’expérience avec la galerie s’est achevée. J’avais trente ans. J’ai eu envie d’embrasser le monde de l’art sans que les problématiques de marché n’interfèrent. De ce point de vue, mon parcours est assez rare. En France, il existe une cloison mentale entre le privé et le public. Même si en réalité, tout le monde travaille avec tout le monde, il est rare de passer du privé au public et vice versa. On me l’a d’ailleurs souvent reproché. Encore aujourd’hui quand on veut me dénigrer, on m’appelle « le galeriste », comme si c’était péjoratif. Mais j’en suis très fier. Les subventions publiques, les musées, les centres d’art, ne peuvent pas tout. Le privé est essentiel. Les galeristes sont ceux qui permettent aux artistes de manger, de vivre, de continuer à produire. J’ai un immense respect pour ce métier difficile et exigeant.










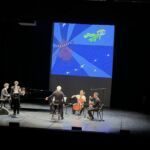





































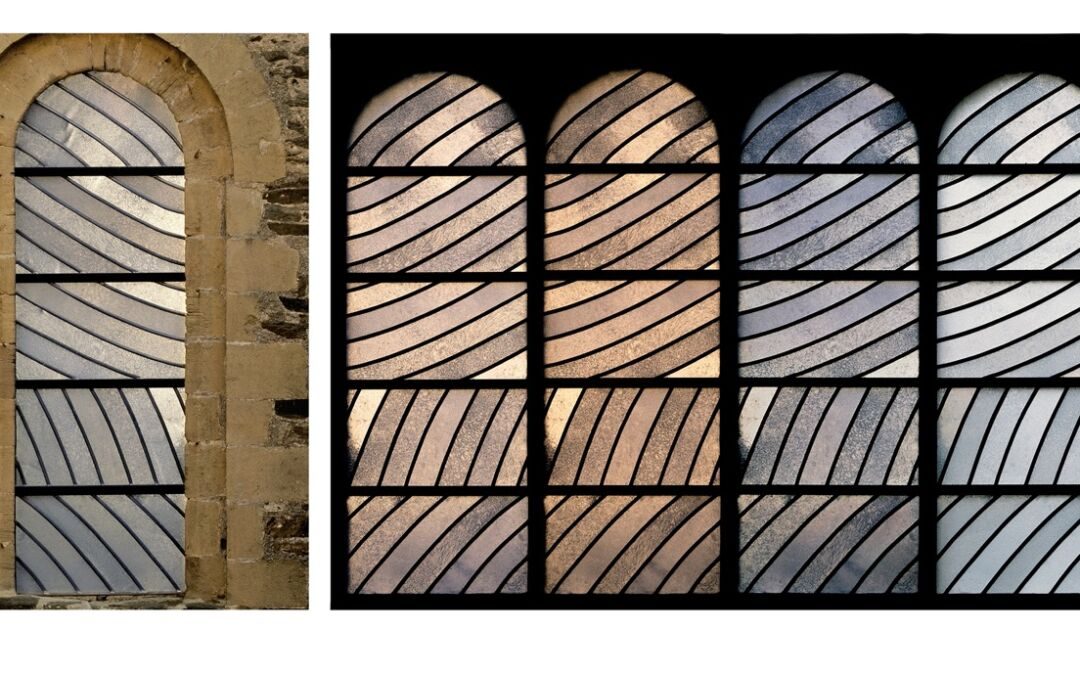
0 commentaires