Du 27 juin au 23 septembre, le pavillon populaire accueille simultanément deux nouvelles expositions : « un dictateur en images. photographies de heinrich hoffmann » et « regards sur les ghettos. photographies de propagande allemande et des photographes juifs des ghettos d’europe orientale (octobre 1939-août 1944) ».
Après avoir montré les images de l’enquête ethnographique de Germaine Tillion et Thérèse Rivière dans l’Algérie aurésienne des années 1930, le Pavillon Populaire présentera simultanément, du 27 juin au 23 septembre inclus, deux expositions intitulées Un dictateur en images. Photographies de Heinrich Hoffmann et Regards sur les ghettos. Photographies de propagande allemande et des photographes juifs des ghettos d’Europe orientale (octobre 1939-août 1944).
Placées sous le commissariat de Alain Sayag et la direction artistique de Gilles Mora, avec la participation du Mémorial de la Shoah, ce cycle d’expositions a un double objectif. Le premier volet consacré aux photographies d’Heinrich Hoffmann, photographe officiel de Adolf Hitler, déconstruit le dispositif de propagande par l’image mis en oeuvre par l’administration nazie en Allemagne entre 1933 et 1945. Démontrant comment la figure de Hitler a pu être mise en scène pour s’imposer à tout un peuple, il rappelle que les photographies du dictateur montrées comme documents d’archive dans les livres d’histoire, ont été conçues et doivent être appréhendées comme des outils de propagande. Le second volet, proposé par la Mémorial de la Shoah, présente plusieurs séries de photographies des ghettos de Pologne. Prises par des inconnus – soldats, fonctionnaires ou captifs des ghettos – ces images « sans filtre » dressent un constat glacial de la réalité, illustrant de manière quasi-clinique un des résultats les plus sordides de la propagande dont l’exposition a, en premier lieu, démontré les ressorts.
UN DICTATEUR EN IMAGES. PHOTOGRAPHIES DE HEINRICH HOFFMANN
Heinrich Hoffmann (1885-1957) est un photographe allemand dont la carrière s’est déroulée essentiellement sous le IIIe Reich. Il fit parti du cercle très réduit des familiers du Führer. Mais comment cet homme, qui n’a occupé aucun poste officiel, a-t-il pu jouer à travers son activité de photographe un rôle de premier plan dans la propagande du régime nazi ? C’est tout l’enjeu de l’exposition, Un dictateur en images. Photographies de Heinrich Hoffmann, présentée au Pavillon Populaire, à laquelle le Mémorial de la Shoah a apporté son soutien, que de démontrer en quoi les photographies de Hoffmann et ses mises en scène de Hitler ont été des outils essentiels de l’idéologie nazie.
Dans le contexte bien particulier de l’Allemagne de 1922 à 1945, l’image du Führer n’est jamais une représentation du monde réel mais une présentation codifiée de celui-ci. Car quelle que soit la place que l’on donne, dans l’histoire, au personnage d’Adolf Hitler, son image est au centre du régime nazi. Et ces traits délibérément « statufiés », ce sont les photographies de Heinrich Hoffmann qui les ont figés dès les premières années du parcours politique de celui qui n’était alors qu’un tribun de brasseries et qui allait incarner, « sous les yeux de la Déesse Histoire », le destin de l’Allemagne.
Examiner ce corpus bien particulier nous contraint à une certaine neutralité, mais est-ce possible face à une figure historique qui incarne le mal absolu ? Cela dit, c’est l’ennui qui est ici le danger principal. L’ennui face à ces milliers d’images de facture plutôt médiocre de défilés, de réceptions, de foules, de remises de décorations ou de réunions d’Etat-Major. Ennui qui masque l’essentiel qui, lui, n’est ni représenté ni représentable, et que Hoffmann se garde bien de photographier. C’est pourtant bien ces images qu’il faut analyser attentivement. Celles qui ont fait d’un bohème raté, d’un déclassé qui mène à Vienne avant la Première Guerre mondiale une existence obscure et famélique, l’homme qui décide en 1933 de la politique mondiale et devient l’objet de la fascination de tout un peuple.
Hoffmann se veut en quelque sorte transparent par rapport à « l’objet » qu’il photographie, il n’est, dit-il, qu' »un outil » entre les mains du tribun. Ultérieurement, ce sera, bien sûr, une stratégie pour s’exonérer de toute responsabilité, mais cela ne doit pas masquer le fait que le maître d’oeuvre n’est pas le photographe mais plutôt le photographié.
Les photographies d’Heinrich Hoffmann ne relèvent donc pas d’une recherche esthétique. Les images sont sans style, d’une banale médiocrité. Leur finalité n’est pas esthétique, elles visent à obtenir l’adhésion du « peuple » par un matraquage massif et continu, dans le cadre d’une propagande qui « doit devenir une foi, afin que l’on ne distingue plus ce qui est du ressort de l’imagination et ce qui est la réalité ».
Un catalogue de l’exposition Un dictateur en images. Photographies de Heinrich Hoffmann réalisé avec les historiens Denis PESCHANSKI et Johann CHAPOUTOT est disponible aux éditions Hazan.
REGARDS SUR LES GHETTOS. PHOTOGRAPHIES DE PROPAGANDE ALLEMANDE ET DES PHOTOGRAPHES JUIFS DES GHETTOS D’EUROPE ORIENTALE (OCTOBRE 1939-août1944)
Durant la Seconde Guerre mondiale, les ghettos créés par les nazis dans les villes d’Europe orientale attirent non seulement les photographes travaillant pour les services de propagande national-socialiste, mais aussi un certain nombre de « touristes » des troupes d’occupation. Il convient donc de distinguer « photographies officielles », souvent mises en scène, et celles qui sont prises au « hasard ». Cependant, toutes baignent dans la même atmosphère, participant plus ou moins consciemment des mêmes stéréotypes.
Comme l’écrit le philologue Viktor Klemperer, le IIIe Reich parle « avec une effroyable homogénéité à travers toutes ses manifestations, à travers l’ostentation démesurée de ses édifices pompeux, à travers le type de soldats, SA et SS, qu’il fixait comme des figures idéales sur des affiches toujours différentes mais toujours semblables, à travers ses autoroutes et ses fosses communes », comme à travers la figure du juif stigmatisée et haïe.
Les photographes juifs, eux, essaient de restituer, malgré toutes les contraintes, l’image d’une société qui tente de préserver une certaine normalité. Dès septembre 1939, les juifs allemands ne peuvent plus posséder d’appareils photographiques, mesure étendue rapidement à tous les ghettos. Les photographes travaillant pour l’administration juive, les « judenrat », reçoivent l’ordre de « ne prendre aucun cliché à des fins privées ». Mais pour les plus notables d’entre-eux, comme Georges Kadish (1910-1997) ou Mendel Grossman (1913-1945), il s’agissait d' »une mission historique de communiquer des images de ces terribles événements… aux générations à venir ».
Cette exposition, reprise à partir d’une partie des documents rassemblés par le Mémorial de la Shoah en 2013, n’a pas l’ambition de dérouler l’histoire du ghetto. Elle nous présente un miroir où se croisent les perspectives portées par chacun de ces regards photographiques particuliers sur les Juifs d’Europe orientale, quelques instants avant leur disparition.
L’exposition présente près de 150 photographies peu connues des ghettos. Issues de plusieurs collections réparties en Europe, en Amérique du Nord ou en Israël, elles ont été prises dans différents ghettos (plus de 400 ghettos existèrent). Elles retracent l’histoire de ce que furent l’enfermement et la mort lente de plusieurs centaines de milliers de Juifs, de 1939 à 1944.
www.montpellier.fr






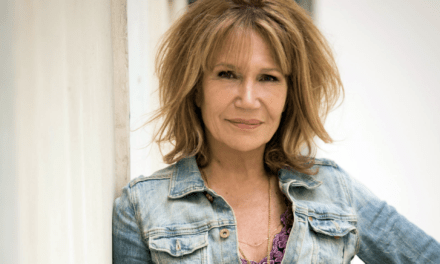



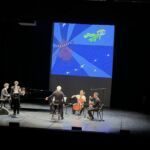

















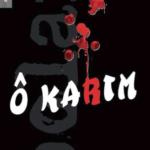

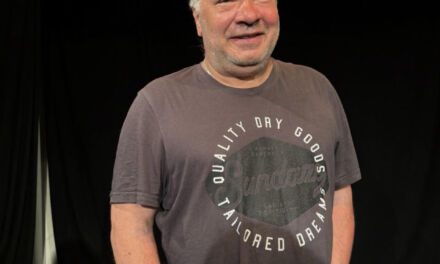
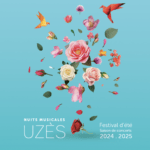










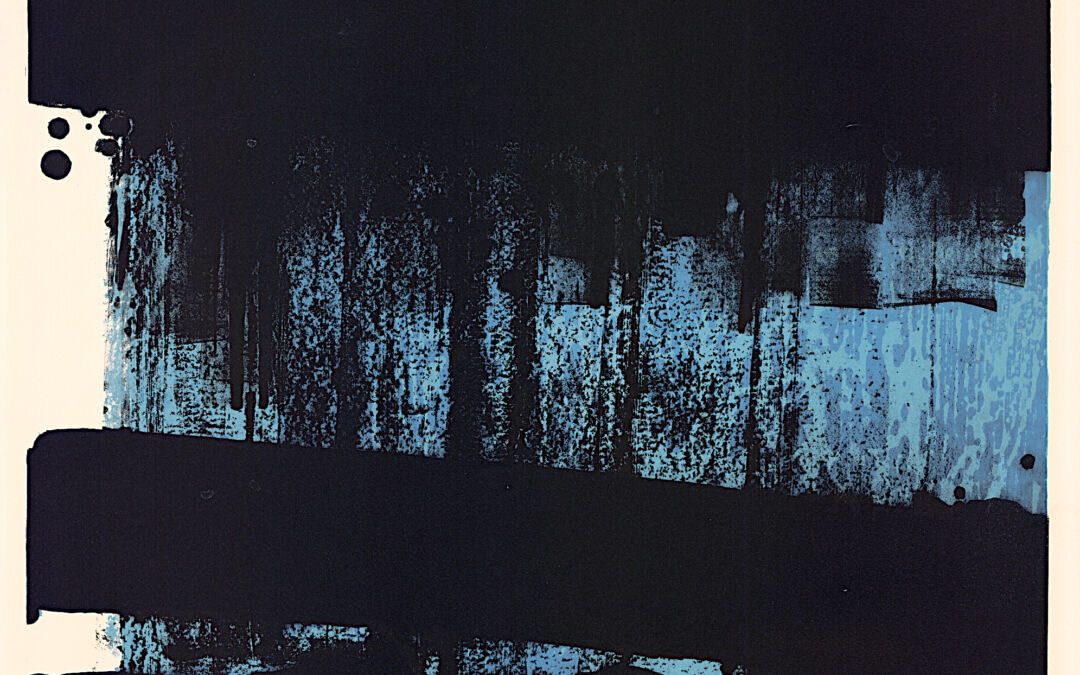
0 commentaires