Là où les eaux se mêlent, Biennale de Lyon
A deux et heures et demie de notre région, on a l’opportunité de se plonger dans l’une des manifestations les plus prestigieuses de la planète ; il serait dommage de ne point en profiter. Le titre indique bien le statut géographique de Lyon mais il va de soi qu’il est métaphorique, et notamment de l’art, capable de recevoir toutes les influences (sociales, politiques, technologiques, scientifiques, spectaculaires…) et d’assurer la mémoire de l’eau avant d’irriguer elle-même la plupart des champs qu’elle implique.
Les anciennes usines Fagor, qui accueillaient cette quinzième édition, à la volumétrie impressionnante, offrent quatre halles et un hall, séparés par l’arche ésotérique de Shana Moulton où se répartissent les diverses œuvres, à commencer par le Bureau des pleurs dès l’entrée, qui rend hommage à l’ancien univers du travail industriel. Cette donnée sera présente tout au long de cette Biennale : le monde du travail et de la technique dans ses rapports à l’art. La halle 1 est immense. Elle permet aux artistes de déployer leurs œuvres, donnent une impression de pléthore qui renvoie quelque peu à la vie trépidante de la ville moderne. On n’est pas là, à la thaïlandaise Pannaphan Yodmanee près, pour méditer mais pour s’immerger dans le monde et ses diversités. Cela va des ronciers en aluminium de Jean-Marie Appriou, aux plateformes vantant les vertus du café du colombien Felipe Arturo en passant par les balles de carton empilées par le taïwanais Yu-Cheng Chou. Au milieu des arbalètes et hélices du vietnamien Thao Nguyen Phan ou des formes gonflables de Leonard Martin, l’espace de prestidigitation de Lenka Clayton et John Rubin représente un havre de silence et de réflexion sur le statut des gardiens ou médiateurs. Tout comme le silence de cette vraie dune isolée où se désole une moto immobile et son sillon circulaire, conçue par Stéphane Thidet. L’œuvre de l’anglaise Rebecca Ackroyd sort du lot, en résine et en cire, dans un rouge sanglant qui hante ses meubles, parties de corps, hublots d’avion. Que l’on aime ou pas, on ne peut pas ne pas citer les animaux-moteurs de l’italien Nico Vascarelli, les robes d’enfants qui montent et descendent du mexicain Fernando Palma- Rodriguez où les matériaux urbains tout trouvés, containers et sacs plastique, de l’africain du sud Megan Rooney.
La Halle 2 est beaucoup plus intimiste et plongée dans la pénombre. Bianca Bondi y a reconstitué une cuisine dont tous les éléments sont baignés et couverts de cristaux chimiques colorées. La coréenne Minouk Lim a imaginé un canal d’eau serpentant dans la lumière électrique et transportant une boule de flipper. Chacun fera le lien avec la ville ou le lieu d’accueil, ou tous les flux qui viennent à l’esprit. Même si la vaste tache savonneuse de Nicolas Momein frappe l’attention et les sens, on est surtout bluffé par la vidéo panoramique de l’inénarrable Abraham Poincheval, marchant et séjournant dans les nuages. L’installation souterraine des autrichiens Ashley Hans Scheirl et Jackob Lena Knebl, nous invitant à essayer des habits inédits ou imitant Louis de Funès, mérite que l’on s’y attarde. La suissesse Pamala Rosenkraz nous promet une éternelle jeunesse en passant de la poudre de maquillage, en large cercle au sol, chaque jour à l’eau d’Evian.
Je n’ai pas aimé la halle 3, trop chimique à mon gré, malgré le Prométhée alambiqué de Thomas Feuerstein et l’installation sonore de Marie Reinert à partir de platines et vinyles se souvenant des sons du travail. On y sent trop la présence du lieu qui prend le pas sur la production des artistes (la tête foreuse investie par l’irlandais Sam Keogh).
La Halle 4 donne vraiment l’impression de remplissage. Le kosovar Petrit Halilaj, dont la vidéo conflictuelle ne manque pas d’intérêt, en occupe la majeure partie avec des décors gigantesques en bois essentiellement, parfois un peu piranésiens. On évoquera aussi la montgolfière en crinoline de la moscovite Taus Makhacheva. Et la fameuse thaïlandaise qui même époque et esthétiques en combinant pipe-line de béton et freques bouddhistes.
Le MAC semble évidemment minuscule au regard des 25000 m2 des anciennes usines d’électroménager. Deux étages sont consacrés au duo franco-britannique Dewar et Gicquel, qui œuvrent sur bois de chêne, soit dans l’espace, avec des meubles traditionnels mais affublés d’intestins ou d’animaux inattendus, dans un pur esprit fantaisiste, soit de manière murale, en associant l’homme nu à son vis-à-vis animal, ou en jouant avec le démembrement et la répétition du corps humain. Art et artisanat, création et savoir faire, font ici à nouveau bon ménage. A l’étage inférieur, on se sent submergé par les immenses fresques murales de Renée Levi et on découvre l’univers tragique de la cubaine Jenny Feal, avec des placards usinés cachant les horreurs de l’Histoire et un livre ouvert aux pages de jute en hommage à l’aïeul écrivain, disparu. Ou Gaelle Choisne (100 artistes dans la ville : la fontaine de chocolat) installant une serre où des bassins de céramique alimentent un système hydraulique arrosant des images de fleurs. Tout autour de cette serre, se déploie l’univers familial de l’artiste avec son bar illégal, des tableaux en tissus, des gâteaux en céramique contenant des mystères… J’ai bien aimé, dans l’escalier, les fenêtres de Karim Kal, et à l’accueil, les sigles liquéfiés par Aguirre Schwarz.
A Villeubanne, à l’IAC, la jeune création (me) déçoit quelque peu dans la mesure où l’on a l’impression, en permanence, de déjà vu, d’un air du temps (gros succès de la céramique, obsession du corps démembré, hétérogénéité des matériaux combinés, hybridité culture/Nature…). Charlotte Denamur, avec ses tissus en coton déployés à partir du plafond, plonge dans un espace vaporeux des plus réconfortants. On est tout de même
content de voir une régionale, Naomie Maury, dans une installation hybride, le travail sur la guérison de Jean-Baptiste Perret et le ciné d’animation sur des rats, en papier, du taïwanais Zhan Zhang Xu. Les petits assemblages, paysages minuscules, de Théo Massoulier tranchent avec le gigantisme présent dans les autres lieux. Pour terminer, un hommage à la Fondation Bullukian, avec la production sculpturale et la façade de ciment vermoulé de Jérémy Gobé, qui redéfinit le travail fédérateur de l’artiste aujourd’hui, parmi toutes les disciplines qu’il brasse, et techniques qu’il est amené à maîtriser, sans compter son implication sociale et politique ou écologique. Et celui de l’italien Andréa Mastrovito, qui ressuscite la marqueterie, redessine pour le cinéma d’animation le Dracula de Murnau ou encore fabrique des vitraux régulés, tout ceci en sollicitant le monde du travail industriel ou artisanal. J’ai adoré ses parterres de fleurs, découpés comme des pop up. Franchement c’est ce que j’ai préféré avec Poincheval, Ackroyd, le duo autrichien, Bondi, Thidet et les deux jeunes femmes du Mac (Feal, Choisne). Mais chacun devrait y trouver de quoi se sustenter. BTN
Du 18 septembre 2019 au 5 janvier 2020, Usine Fagor Lyon 7 ; Mac, Lyon 6, IAC Villeurbanne, Bullukian Lyon 2.0427466560










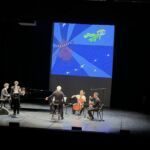



































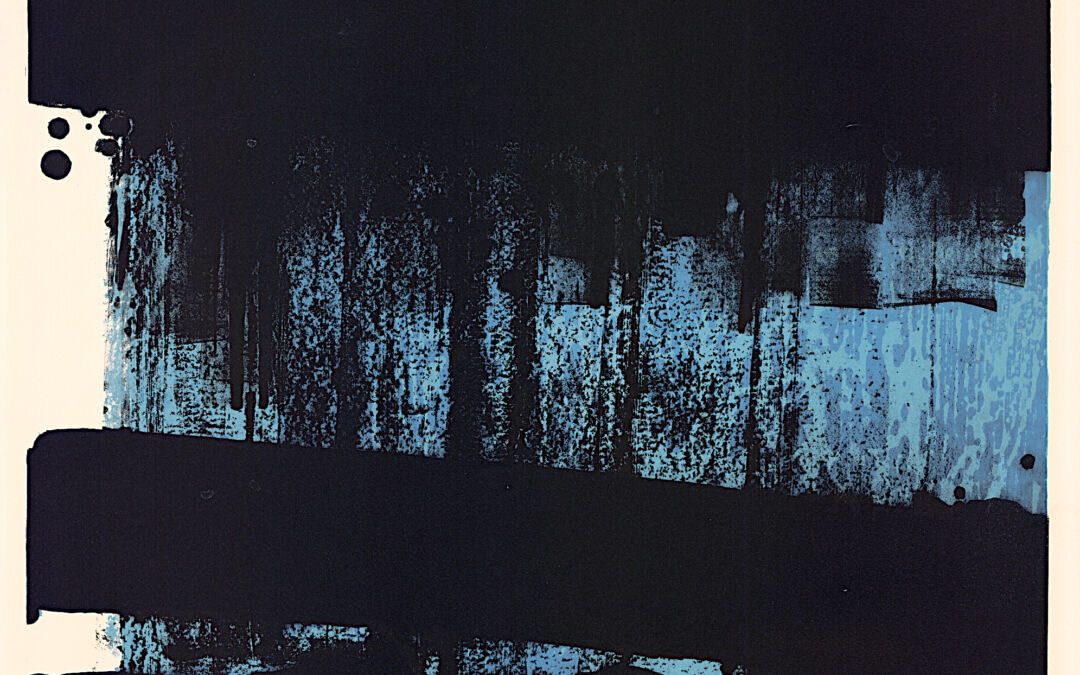
0 commentaires