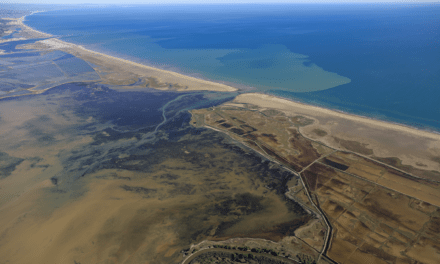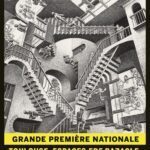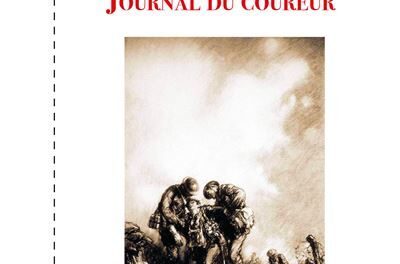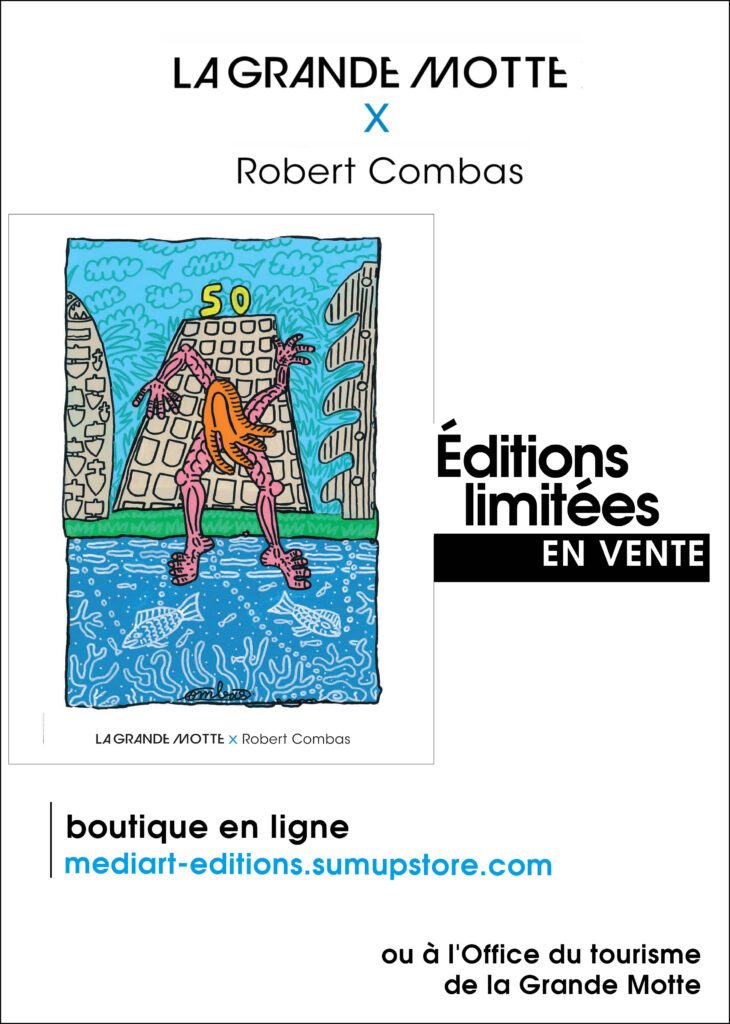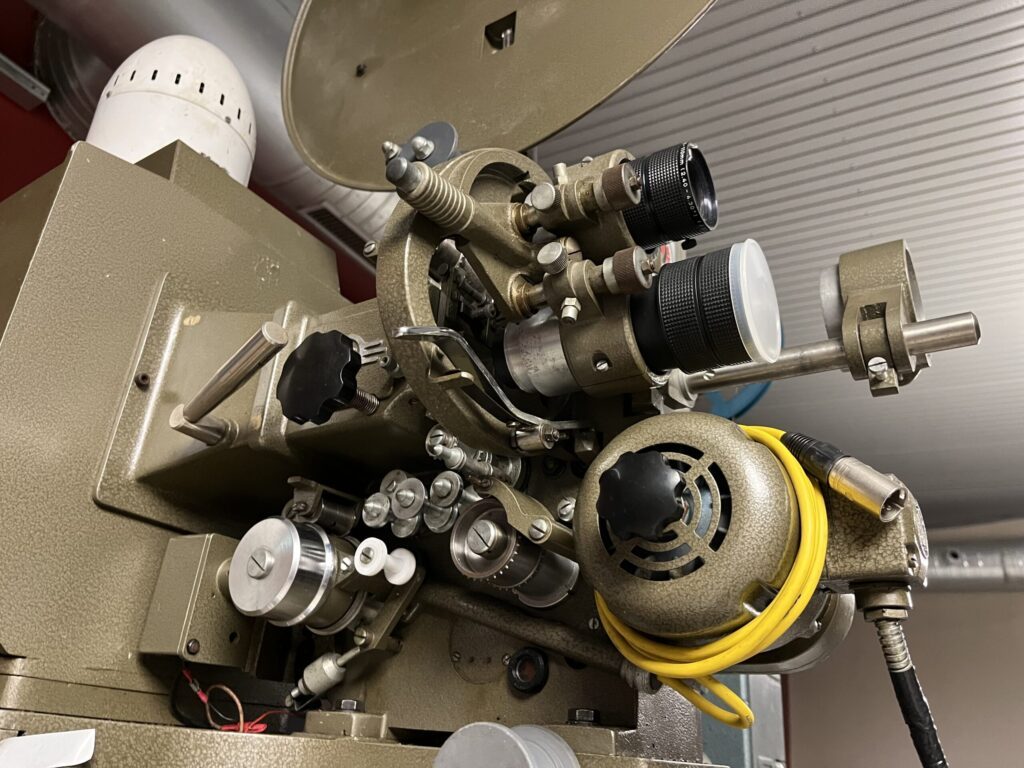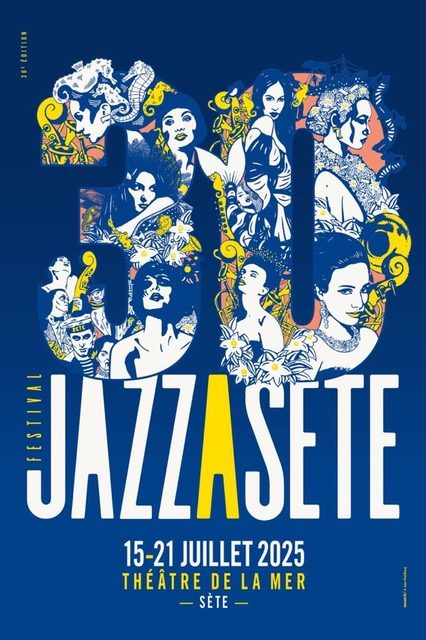La 76ᵉ édition du Festival d’Avignon bat son plein ! Retrouvez sur notre site, notre sélection du Off (du 7 au 30 juillet) et les spectacles du In (jusqu’au 26 juillet) pendant la durée du festival.
Je ne cours pas, je vole !
« Dans quarante minutes, moi, Julie Linard, je courrai la demi-finale du 800 mètres des J.O. Cela fait douze ans que je m’entraîne, et que j’attends ces deux minutes de course avec pour objectif la médaille d’or olympique. »
On a le cœur qui bat en ce départ de course, on a envie de se lever pour crier « Allez Julie ! », aux côtés des siens qui l’encouragent, puis de se rasseoir, bon sang, puisqu’on est au théâtre, même si la scénographie transforme l’espace en piste d’athlétisme avec ses lignes tracées au sol, ou bien encore en aire d’interview. Je ne cours pas, je vole ! entraîne le spectateur, sans le lâcher d’une semelle, dans une course palpitante d’une heure et demie qui alignent quelques grandes pointures du sport international, toutes disciplines confondues, comme Usain Bolt, Gebrselassie, Nadal, une gymnaste russe Rita ou bien encore Laure Manaudou. Six comédiens au talent et au souffle puissants les incarnent, c’est justice de tous les citer : Vanessa Cailhol, formidable Julie, Olivier Dote Doevi, Axel Mandron, Youna Noiret et Laurent Paolini qui interprètent également, une fois la compète terminée, les parents, le petit frère, les amoureux, les amis, le coach, les concurrents et les journalistes. Actrice elle aussi, Elodie Menant (Molière de la révélation féminine 2020 et prix SACD pour ce spectacle dont elle écrit le texte), nous plonge dans le milieu de la haute compétition, avec ce questionnement : de quoi est faite la vie d’un sportif de haut niveau, quels sont ses rêves et ses motivations pour dépasser ses limites, et au prix de quels sacrifices ? Mais aussi : que reste-t-il quand le rêve se brise à la suite d’une blessure, que l’on quitte l’Olympe pour rejoindre le sort du commun des mortels, comment se réadapter, se reconvertir ? Bien au-delà du sport, ce spectacle parle aussi de réussite, de réalisation de soi et de la place de l’amour dans nos vies.
La mise en scène chorégraphiée de Johanna Boyé – on pense à ces superbes ralentis sans parole mais si éloquents des corps en mouvement – enchaîne les séquences alternant scènes de compétition et moments intimes avec la famille et les amoureux, tandis que des flash-back produisent un précipité d’action qui donne tout son rythme au spectacle. Mécanique impeccablement réglée comme la course d’un coureur de fond, Je ne cours pas, je vole ! emballe le public et mérite de figurer tout en haut du podium du Off.
Théâtre du Roi René à 16h15 jusqu’au 30 juillet.
L.A.
Téléphone-moi
Trois cabines téléphoniques composent le décor de la pièce et balisent les époques successives où se déroule l’action : la première pendant la guerre et l’occupation allemande, la seconde au moment de l’élection présidentielle de 1981 et la troisième en 1998. Trois espaces clos dans lesquels se jouent des mini-drames dont on comprendra peu à peu qu’un lien familial les relie, sorte de constellation familiale dont Eros et Thanatos tirent les ficelles. C’est cette découverte progressive de la filiation qui est le moteur dramatique de la pièce.
Dans la première cabine, une Résistante fait la rencontre d’un musicien et suscite la jalousie d’un compagnon de lutte. Enceinte du premier, elle donne naissance à un enfant, Louis, qui sera élevé par l’ami après l’exécution du père par les Allemands. Un homme à la rue, nommé Louis comme par hasard, qu’on devine en rupture familiale, squatte la seconde cabine qu’il a transformée en appartement. Il téléphone souvent aux siens, dernier fil qui le relie à sa vie d’avant, il ment sur sa situation à son père comme à sa femme ou sa fille qui s’appelle Léo, et il va jusqu’à réinventer l’issue d’un match de football historique (la demi-finale France-Allemagne de 1982 à Séville) pour que son fils dans le coma puisse mourir en paix. On retrouve Léo dans la troisième cabine autour des années 90, punkette à la dérive avant qu’une maternité ne la remette sur les rails. Le puzzle transgénérationnel se construit ainsi peu à peu sous nos yeux, l’action éclatée gagne en cohérence jusqu’à ce que l’histoire nous soit livrée dans toute sa logique et réunisse à la fin le grand-père, le père et sa fille.
Téléphone-moi nous livre à la fois des histoires intimes dramatiques et les échos d’événements accompagnés de liesse collective (la Libération, les coupes du monde de football, mai 1981, etc.), tissant la trame d’une dramaturgie où se meuvent des personnages qui, de mensonge en non-dits, ne savent plus aimer. Souvent émouvant, interprété par des comédiens au verbe et aux gestes justes, Téléphone-moi nous parle aussi d’un temps où la France comptait 300 000 cabines téléphoniques. Préoccupée de maillage culturel, la compagnie F.o.u.i.c. installée en Franche-Comté est à l’origine d’un projet autour des cabines téléphoniques en trois volets, deux spectacles qu’on peut voir dans ce même théâtre du 11 et une exposition à la Maison Jean Vilar.
Au 11 à 18h10 jusqu’au 29 juillet.
L.A.
Artemisia Gentileschi
On est en 1612 en Italie et la jeune Artemisia Gentileschi accuse le célèbre peintre Agostino Tassi de l’avoir violée. Le procès est resté dans les annales, il a agité le monde politico-religieux et le milieu artistique de la Renaissance italienne et il en reste des transcriptions. Le groupe Vertigo s’en empare pour en restituer les faits les plus saillants à travers ce spectacle, Artemisia Gentileschi, qui transforme en tribunal la salle du Train Bleu, théâtre où il est bon de faire escale tant la qualité d’ensemble de la programmation mérite d’être saluée.
Ce qui est aujourd’hui devenu un combat médiatisé mais encore à poursuivre, la dénonciation des violences faites aux femmes, était rare à une époque de patriarcat où leur parole était dominée par celle des hommes. C’est ce qui donne son caractère exceptionnel à ce procès au terme duquel la plaignante finira par obtenir la condamnation du violeur. Lequel put reprendre, soit dit en passant, son travail de peintre officiel de la cour du Pape après quelques années de prison, puisqu’à l’époque il n’existait aucun ministère dans lequel on puisse le recaser. On devine aussi, à travers la pièce, tout l’enjeu de pouvoir entre une jeune peintre encore inconnue et un artiste officiel protégé par les puissants.
La mise en scène de Guillaume Doucet situe les protagonistes dans une enceinte judiciaire, les auditions se font face au public, mettant le spectateur dans la peau d’un juré. « Faire passer de l’être, pas du discours », revendique le metteur en scène dans sa note d’intention, et c’est ce qui donne sa force aux scènes du procès parfois un peu surjouées, surtout quand l’accusé proteste de son innocence avec une emphase qui fait trembler les témoins et les murs, on avait bien compris que ce type était odieux. Les trois comédiennes sont convaincantes, toujours justes, jamais dans le mélo. Dans un hors champ pertinent, il y a un rappel à l’histoire de l’art et à la production personnelle de la jeune Artemisia Gentileschi et à son tableau Judith décapitant Holopherne dérobé par le violeur qui craignait sa suggestivité accablante lors du procès. La peintre y exprimait toute la détermination du combat qui la conduisit à remettre en cause les pouvoirs de ce temps.
Le train bleu à 20h20 jusqu’au 27 juillet
L.A.
Et aussi…
Un héros. Quadragénaire au chômage, Semione partage avec sa femme, qui subvient aux besoins du ménage, un quotidien plombé dans une banlieue du même métal cernée par les usines. Déprimé, il décide de se supprimer en guise d’acte de rébellion définitive à sa condition. Prévenue, sa femme alerte leur entourage qui entrevoit la possibilité, à travers ce suicide, de faire entendre des revendications collectives, ce qui rendrait cette mort utile. Et chacun, dès lors, de convaincre le chômeur de se suicider et d’œuvrer ainsi pour la communauté reconnaissante. On appréciera mieux l’humour féroce et slave-qui-peut de cette pièce en la replaçant dans le contexte où elle a été écrite par le russe Nikolaï Erdman en 1928, dans un pays en pleine stalinisation. Écarté par la censure dans un premier temps le texte connaîtra bien des déboires, tout autant que son auteur exilé pendant plusieurs années. Traduite par André Markowicz et adaptée et mise en scène par Julie Cavanna, la pièce baigne dans un comique grotesque qui n’est pas sans rappeler parfois celui d’un Ionesco, même si le jeu des acteurs tire davantage vers la comédie foutraque. Théâtre du Roi René à 14h10 jusqu’au 30 juillet.
L’installation de la peur. Et si on vous installait la peur chez vous ? Un peu comme on vous installe la fibre optique, histoire de vous prémunir contre tout malheur, sait-on jamais. C’est avec cette intention que débarquent deux quidams au clownesque inquiétant chez une femme qui vit seule avec son enfant. Sous leurs dehors avenants, les deux compères vont peu à peu devenir des plus menaçants et intrusifs, jusqu’à déclencher la peur puis la furie de la gentille dame qui finit par les écharper. Tout ça est tissé du fil d’un humour noir parfois un peu épais qui nous rappelle par moments le théâtre absurde et grand guignol d’un Coppi vers lequel la mise en scène d’Alain Timar oriente malignement la pièce écrite par le Portugais Rui Zink. Théâtre des Halles à 19h jusqu’au 30 juillet.
Parfois j’aimerais avoir une famille comme celle de la petite maison dans la prairie. Oui mais voilà, Mirta Bertotti n’a pas hérité d’une famille comme ça, elle qui doit gérer une maisonnée pas mal déjantée composée d’un mari au chômage, Zacharias, et de trois enfants en crise. Le plus jeune, Caio, a été renvoyé pour avoir mis le feu à son école, la fille ado, Sofi, fait se dénude sur Instagram pour récolter quelques dollars et l’ainé, Nacho, ne parvient pas à annoncer son homosexualité à sa famille. On est en plein « corralito » en 2002, temps de crise économique et de vaches maigres pour tous les Argentins qui doivent déployer des trésors d’imagination afin de survivre au quotidien, comme Mirta qui vend ses beignets dans le quartier. Un quotidien que raconte Mirta sur son blog, entre journal intime et chronique sociale. Sur scène, Viviana Souza slalome entre frigo vide, machine à laver et quelques ustensiles domestiques valdinguant d’un bout à l’autre de la scène pour dérouler cette histoire tirée du roman d’Hernán Casciari, savoureuse comme une empanada de son pays. La Scierie à 21h30 jusqu’au 28 juillet.